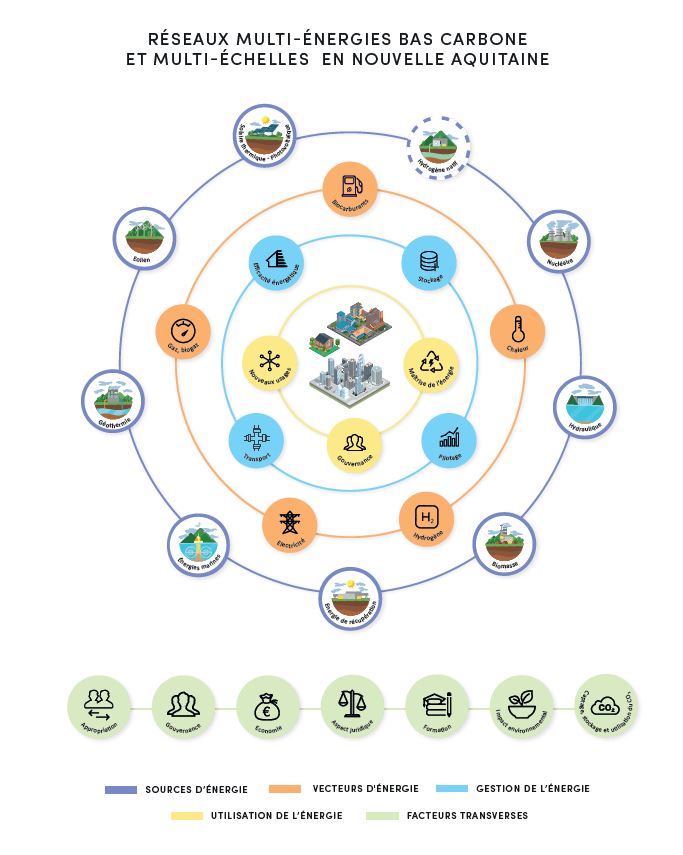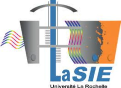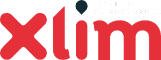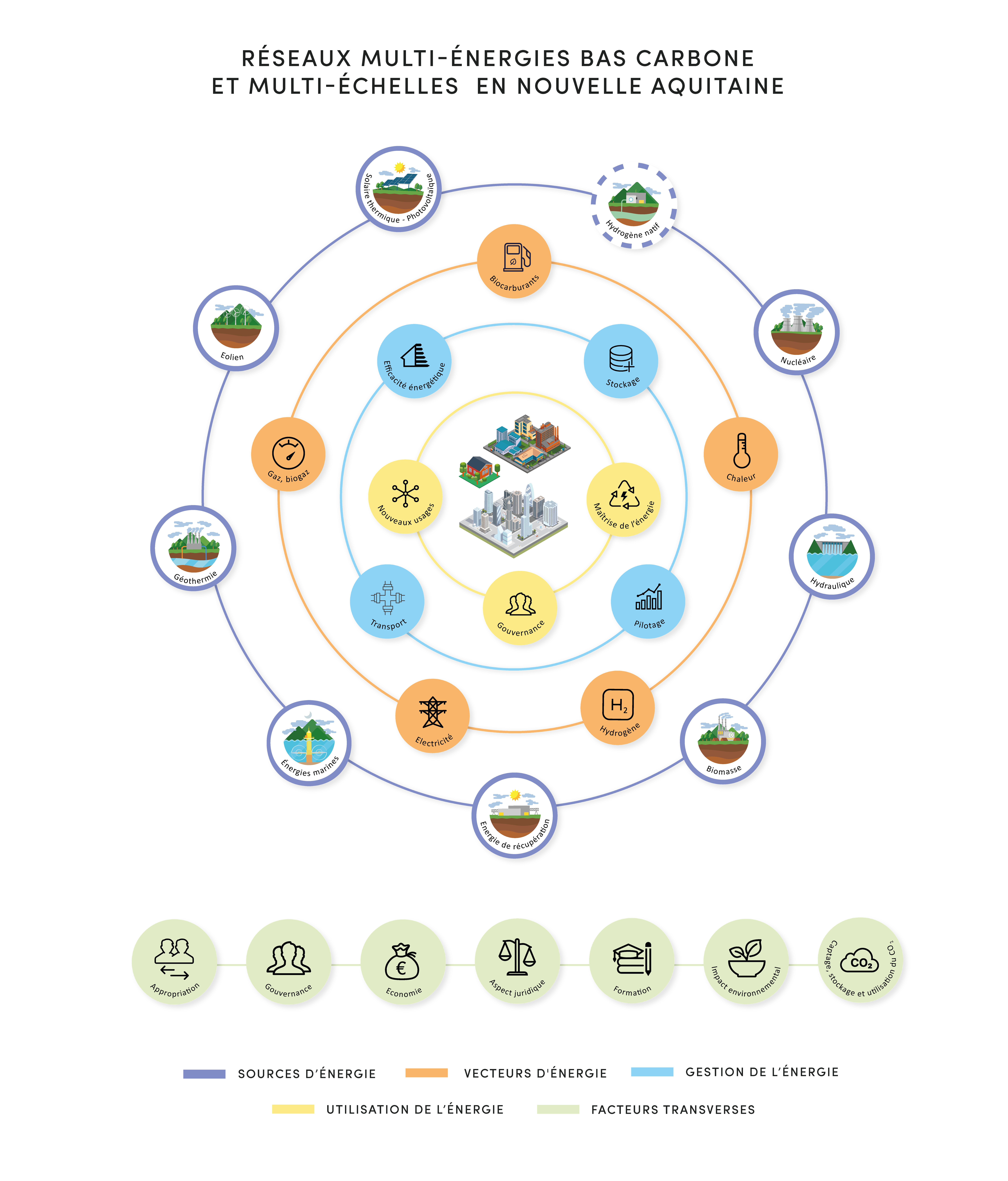
Qu’est-ce que le R3 TESNA ?
R3 TESNA est né d’un dispositif de la Région Nouvelle-Aquitaine pour animer une communauté de laboratoires de recherches pluridisciplinaires néo-aquitains sur les réseaux multi-énergies bas carbone et multi-échelles. Il rassemble les cinq sites d’Enseignements Supérieur et de Recherche et est coordonné par l’Université de Pau et des Pays de l’Adour. Le R3 TESNA s’inscrit dans les actions de la feuille de route stratégique de NéoTerra, dédiée à la transition énergétique et écologique de la Région Nouvelle-Aquitaine.

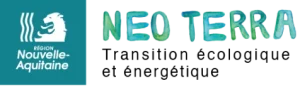

Les chiffres clés
![]() +30
+30
unités de recherche
![]() +450
+450
chercheurs
thèmes de recherche
Les dernières actualités

Nouvelle date – Les Rencontres Laboratoires-Entreprises de la transition énergétique
📢 Suite à des travaux à l'Hôtel de Région de Bordeaux, l'évènement est...

Webinaire AREC
Le R3 TESNA et l'Agence Régionale d'Evaluation Environnement et Climat (AREC)...

R3 TESNAGORA 2025
Comme les années précédentes à La Rochelle, à Pau et à Limoges, le séminaire...

Céramiques pour le stockage thermique de l’énergie
Le groupe Français de la Céramique (GFC) et le R3 TESNA avec le soutien de la...

RDV FILIERE BATTERIES
Le R3 TESNA est partenaire des rendez-vous des acteurs de la filière batteries...
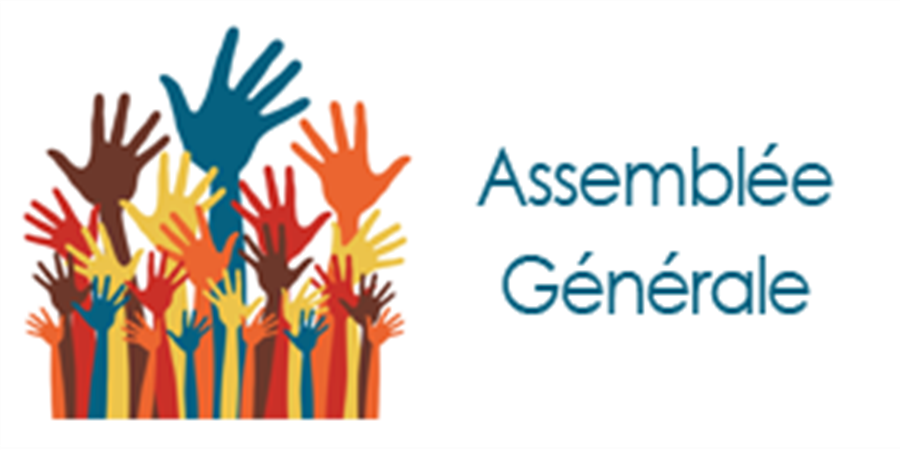
Assemblée Générale du R3 TESNA
Acteurs de la transition énergétique (chercheurs, enseignants-chercheurs,...

SAVE THE DATE R3 TESNAGORA
Le séminaire annuel du R3 TESNA aura lieu les 6 et 7 octobre 2025 à la MSHS de...

LANCEMENT DES PSGAR
La Région Nouvelle-Aquitaine a mis en place les « Programmes...

Maîtriser l’art oratoire
Dans le cadre de ses actions, notre partenaire S2E2 propose une formation...
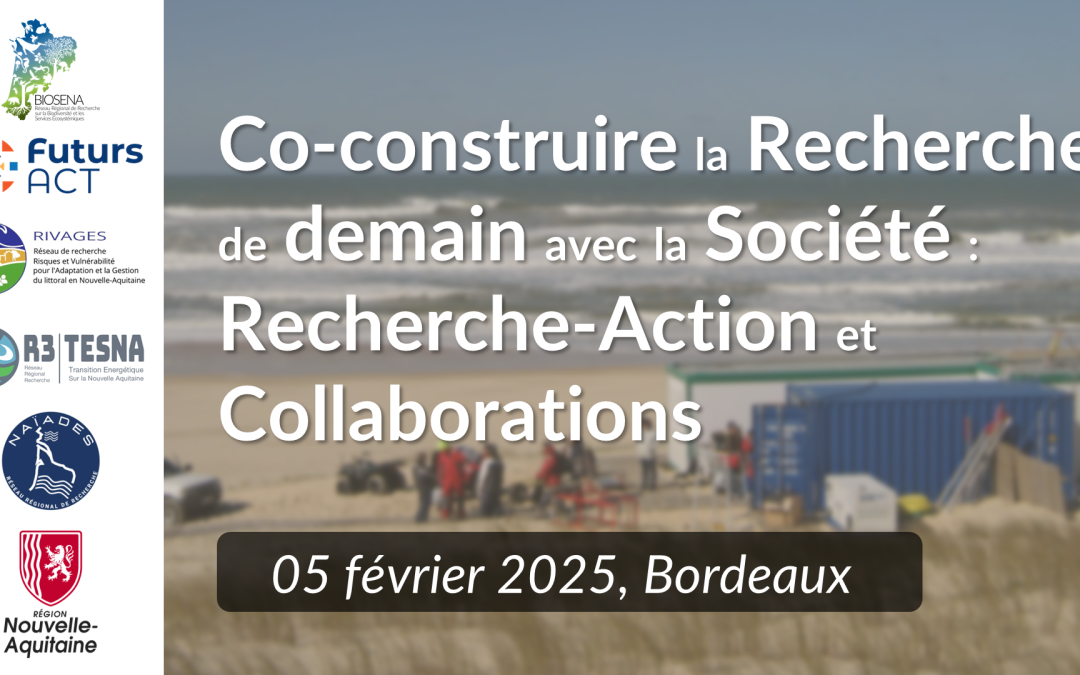
Co-construire la Recherche de demain avec la Société : Recherche-Action et Collaborations 05/02/205
Les réseaux régionaux de recherche BIOSENA, FUTURS ACT, NAIADES, R3 RIVAGES et...
Les missions du réseau
Mobiliser
un collectif néo-aquitain pluridisciplinaire afin d’identifier les complémentarités et les synergies des actions de recherche pour des réponses collectives à des appels à projets.
Être
un point d’entrée sur les compétences des laboratoires du R3 pour les acteurs de l’énergie.
Incuber
des projets de recherche inter-labos néo aquitains sur des AAP Région, ANR, Europe.
Renforcer
l’interface avec l’écosystème socio-économique pour mieux valoriser l’innovation technologique issue des laboratoires et pour lever les verrous technologiques rencontrés dans l’industrie.
Augmenter
la visibilité de la recherche en Nouvelle-Aquitaine au niveau national et international pour devenir une référence sur son périmètre scientifique
Contribuer
à diffuser la culture scientifique auprès du grand public et des collectivités territoriales sur les sujets des énergies renouvelables afin d’en faciliter l’appropriation.
Les axes de recherche
Axe 1 : Les nouvelles technologies de l’énergie (NTE), productions et conversions multiples délocalisés et couplages
La décentralisation de la production d’énergies bas carbone est fortement liée au développement des nouvelles technologies de l’énergie. Si certaines sont matures comme l’éolien ou l’hydraulique avec des besoins d’optimisation, d’autres sont encore en développement comme le solaire ou l’hydrogène natif.
Les énergies renouvelables sont souvent produites ou récupérées localement, multipliant ainsi les points d’injection d’énergie dans les réseaux. Le positionnement multi-vecteurs implique quant à lui des technologies de conversion à haut rendement pour les finalités de transport, de stockage ou de consommation. L’implantation locale de ces énergies renouvelables et de leur système de conversion nécessite la concertation avec le territoire qui les accueille. Le cadre législatif et économique qui l’accompagne doit aussi évoluer pour permettre une gestion décentralisée de l’énergie régulée et non-régulée.


Axe 2 : Le transport et le stockage de l’énergie
Les vecteurs énergétiques sont acheminés via de grands réseaux nationaux de transport et de distribution (gaz naturel, électricité) ou via des réseaux locaux (chaleur, biogaz). La durabilité de ces infrastructures doit être prise en compte dès leur conception. D’une part, le couplage des énergies contribue à augmenter l’efficacité du système par synergie et optimisation des réseaux entre eux.
D’autre part, les sources d’énergies renouvelables (photovoltaïque, éolien) produisant de l’électricité intermittente peuvent générer des excédents qui doivent être stockés. Les dispositifs de stockage peuvent être de différentes natures (thermique, électro-chimique, STEP…) et leurs capacités dimensionnées pour répondre à la variabilité de la consommation. Les modèles économiques doivent être renouvelés pour appréhender comme il convient les bénéfices collectifs du transport et du stockage de l’énergie. De même, tous les dispositifs devront être déployés en concertation avec les territoires.
Axe 3 : Le pilotage et la gestion des flux en temps réel
Ces réseaux sont interconnectés et pilotés afin de répondre à l’équilibre énergétique du système et à la sécurité d’approvisionnement des consommateurs (smart grids). Cette flexibilité nécessite la collecte de données de production et de consommation d’énergie pour la gestion en temps réel de l’articulation entre le transport, la distribution et les mécanismes de stockage.
Des outils de gestion du réseau intégrant les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) et l’intelligence artificielle (IA) sont développés pour assurer un pilotage intelligent permettant d’accéder à une régulation et à un modèle économique satisfaisant. La législation doit permettre la bonne collaboration entre les opérateurs et gestionnaires de réseaux ainsi que d’en contrôler et évaluer la performance.

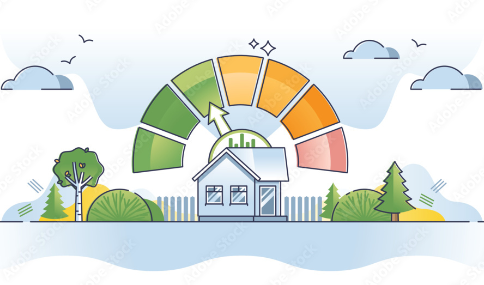
Axe 4 : L’efficacité énergétique et la réduction du gaspillage
La complémentarité des réseaux d’énergie (électrique, chaleur, gaz) est une source importante d’efficacité énergétique. Celle-ci implique des procédés et outils plus efficaces dans la gestion des réseaux (matériaux isolants, optimisation des échanges thermiques, valorisation de l’énergie fatale…).
La législation accompagne également l’optimisation de la consommation d’énergie par la réduction du gaspillage et des consommations inutiles. Cela nécessite un apprentissage de nouvelles façons de consommer l’énergie. Un bilan global sur l’ensemble du cycle de vie du réseau permettra d’en mesurer sa performance environnementale.
Axe 5 : Les liens avec le territoire
Le système énergétique futur sera décentralisé et s’appuiera sur les gisements des ressources locales (éolien, géothermie, biomasse…) et sur les spécificités des territoires (contexte géologique, surfaces agricoles, espaces urbains et péri-urbains…). Le territoire peut également être source de métaux stratégiques indispensables à la transition énergétique.
Les citoyens, les entreprises et les collectivités locales sont des acteurs clés dans la mise en œuvre des projets des réseaux multi-énergies bas carbone et multi-échelle. Une adhésion forte aux projets énergétiques territoriaux, la participation à leur gouvernance (nouveaux modes) et à leur financement seront des facteurs d’accélération de la transition énergétique. Ceci implique un changement de modèle : vers un modèle mixte entre centralisation et décentralisation. Cela pose des questions sur les choix techniques à mettre en œuvre dans un souci de maîtrise des investissements et d’équité pour les consommateurs, sur l’évolution des usages de l’énergie (mobilité, BBC…), sur les modèles économiques soutenables ainsi que sur la prise en compte de l’impact environnemental.

Les membres du réseau
Le réseau pluridisciplinaire rassemble des compétences sur les matériaux, les procédés, les mathématiques, l’électronique, la chimie, la physique, la géologie l’intelligence artificielle, les sciences sociales, le droit, l’économie, la géographie …
La gouvernance
Le Comité de Pilotage (COPIL)
Ses missions
● Définir et valider les choix stratégiques du réseau déclinés dans la feuille de route
● Valider et participer aux actions du réseau
● Suivre l’allocation budgétaire allouée aux actions
● Relayer les informations du R3 auprès de sa communauté
● Partager la veille sur les AAP dans le périmètre du réseau

Pierre CEZAC
Coordinateur - IPRA-LaTEP, Université de Pau et des Pays de l’Adour

Evelyne ROBERT
Cheffe de projet - IPRA-LaTEP, Université de Pau et des Pays de l’Adour

Daniel BRITO
IPRA-LFCR – Carnot ISIFoR - Université de Pau et des Pays de l’Adour

Louis DE FONTENELLE
TREE - Université de Pau et des Pays de l’Adour, CNRS

Jean-Marc BASSAT
ICMCB - CNRS, Université de Bordeaux

Jean-Louis BOBET
ICMCB - CNRS, Université de Bordeaux

Jean TOUTAIN
I2M ENSCBP - Bordeaux INP

Fabrice ROSSIGNOL
IRCER - CNRS, Université de Limoges

Samuel BERNARD
IRCER - CNRS, Université de Limoges

Têko NAPPORN
IC2MP - CNRS, Université de Poitiers

Sylvie CASTAGNET
Pprime - CNRS, Université de Poitiers, ISAE-ENSMA

Jérôme LE DREAU
LaSIE - Université de la Rochelle

Marie FERRU
RURALITES - Université de Poitiers
Le Comité des Acteurs Socio-Economiques (CASE)
Ses missions
● Travailler sur la remontée des verrous technologiques ou sociétaux rencontrés sur le périmètre du R3
● Aider à la détection de partenaires lors du montage de consortium dans le cadre d’appels à projets
● Transmettre les besoins de formation identifiés sur le périmètre du R3

Fayah ASSIH
Responsable du service Transitions Energétique et Environnementale CLUSTER ENERGIES STOCKAGE

Tarik LAOUEDJ
Responsable DAS Energie-Bâtiment intelligent, ALPHA RLH

Aline CHABOT
Chargée de projets innovants, POLE SMART POWER

Thibaut HEIMERMANN
Directeur général, AVENIA

Florine BOULLE
Directrice générale POLE EUROPEEN DE LA CERAMIQUE

Didier LAFFAILLE
Chef du service de la prospective et de l’innovation CRE

Audrey LEBARS
Directrice TERRITOIRE D’INDUSTRIE PAU LACQ TARBES

Alain DECHAMPS
Président CA CIRENA

Rafael BUNALES
Directeur, AREC NA

A venir
ADEME NOUVELLE-AQUITAINE